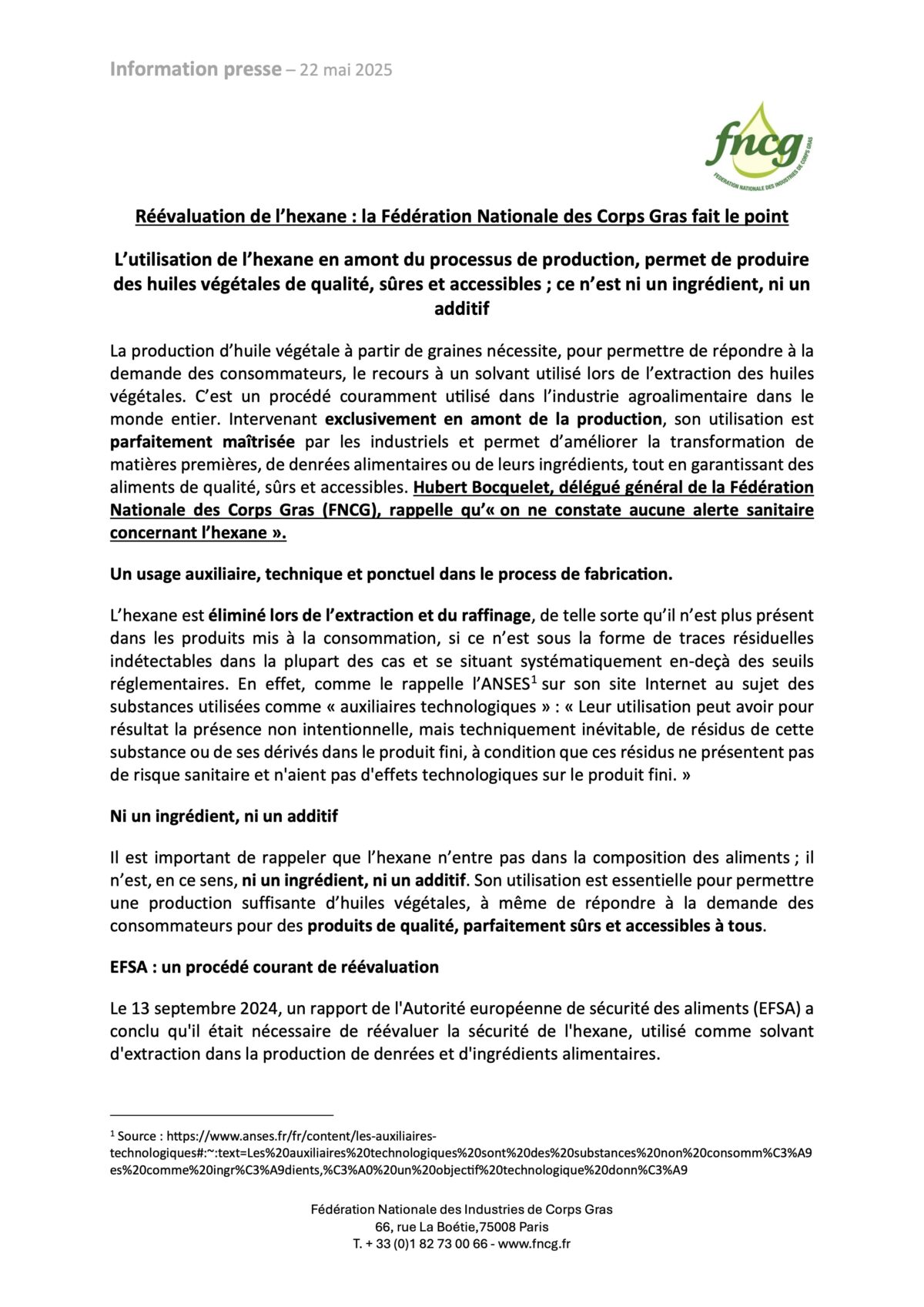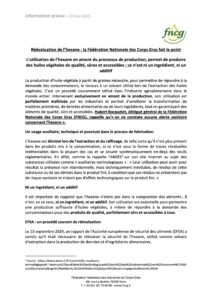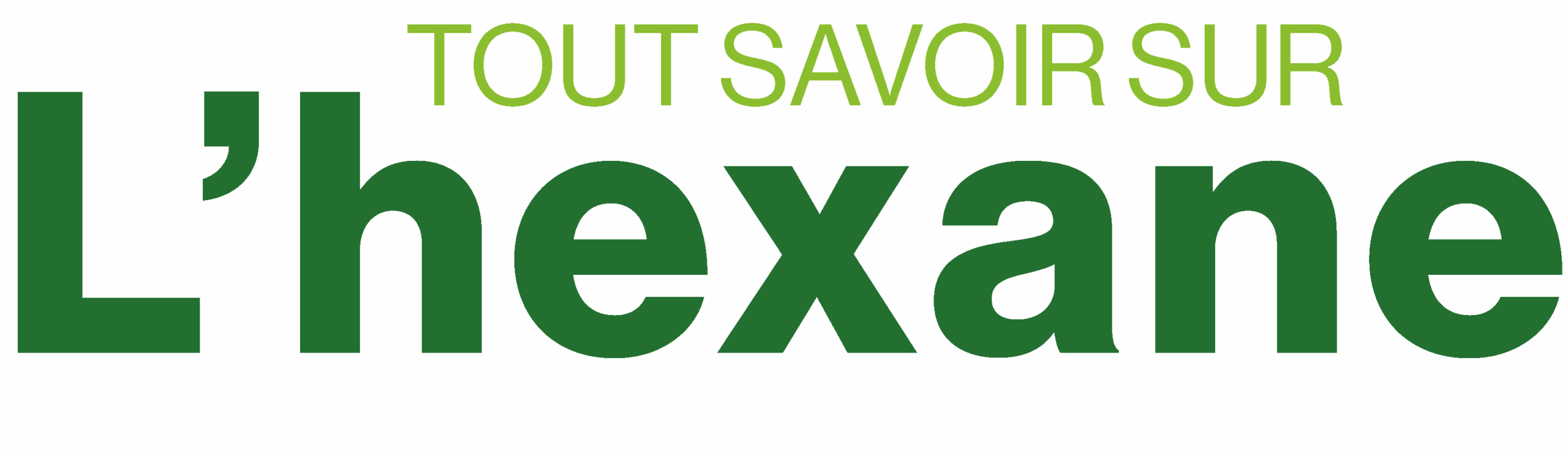
Réévaluation de l’hexane – Mise au point de la FNCG
L’utilisation de l’hexane en amont du processus de production, permet de produire des huiles végétales de qualité, sûres et accessibles ; ce n’est ni un ingrédient, ni un additif.
La production d’huile végétale à partir de graines nécessite, pour permettre de répondre à la demande des consommateurs, le recours à un solvant utilisé lors de l’extraction des huiles végétales. C’est un procédé couramment utilisé dans l’industrie agroalimentaire dans le monde entier. Intervenant exclusivement en amont de la production, son utilisation est parfaitement maîtrisée par les industriels et permet d’améliorer la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, tout en garantissant des aliments de qualité, sûrs et accessibles. Hubert Bocquelet, délégué général de la Fédération Nationale des Corps Gras (FNCG), rappelle qu’« on ne constate aucune alerte sanitaire concernant l’hexane ».
Un usage auxiliaire, technique et ponctuel dans le process de fabrication.
L’hexane est éliminé lors de l’extraction et du raffinage, de telle sorte qu’il n’est plus présent dans les produits mis à la consommation, si ce n’est sous la forme de traces résiduelles indétectables dans la plupart des cas et se situant systématiquement en-deçà des seuils réglementaires. En effet, comme le rappelle l’ANSES[1] sur son site Internet au sujet des substances utilisées comme « auxiliaires technologiques » : « Leur utilisation peut avoir pour résultat la présence non intentionnelle, mais techniquement inévitable, de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini. »
Ni un ingrédient, ni un additif
Il est important de rappeler que l’hexane n’entre pas dans la composition des aliments ; il n’est, en ce sens, ni un ingrédient, ni un additif. Son utilisation est essentielle pour permettre une production suffisante d’huiles végétales, à même de répondre à la demande des consommateurs pour des produits de qualité, parfaitement sûrs et accessibles à tous.
EFSA : un procédé courant de réévaluation
Le 13 septembre 2024, un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu qu’il était nécessaire de réévaluer la sécurité de l’hexane, utilisé comme solvant d’extraction dans la production de denrées et d’ingrédients alimentaires.
Le rapport de l’EFSA correspond à un procédé courant de réévaluation de la sécurité de substances utilisées dans la fabrication des aliments. L’hexane, comme nombre d’autres substances, a déjà été évalué à plusieurs reprises par le passé et cette évaluation doit naturellement être actualisée.
A l’issue de son travail de réévaluation, l’EFSA remettra à la Commission européenne une opinion, à savoir un avis scientifique destiné à informer les décideurs politiques chargés de l’élaboration ou de la mise à jour de la réglementation européenne. Cette opinion pourra conduire, si nécessaire, à l’adoption par la Commission européenne de mesures spécifiques d’adaptation.
Respect des limites de résidus
L’utilisation de l’hexane est autorisée pour différentes applications alimentaires, dont la production d’huile et de protéines végétales, et régie par un cadre règlementaire européen[2] établissant des limites maximales dans les produits, respectées strictement. Ces limites maximales (LMR) correspondent à la teneur maximale légale de résidus autorisée dans un aliment ou un ingrédient alimentaire, généralement exprimée en mg/kg. Elles sont fixées pour protéger la santé des consommateurs et prennent en compte une marge de sécurité. Il faut également noter que la France est le seul Etat européen à avoir renforcé ce dispositif d’autorisation de l’hexane par le biais d’un arrêté sur les auxiliaires technologiques.
Des alternatives font l’objet d’études mais aucune n’est à ce jour déployée à l’échelle industrielle. En effet, la comparaison des solvants potentiellement capables de remplacer l’hexane est complexe et doit prendre en compte des critères multiples, parmi lesquels : la sécurité, la santé/toxicité, l’impact environnemental et la consommation d’énergie des alternatives étudiées, ainsi que l’accessibilité des produits et leur contribution à la souveraineté alimentaire.
[1] Source : ANSES – Les auxilliaires technologiques
[2] Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux solvants d’extraction utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et de leurs ingrédients.