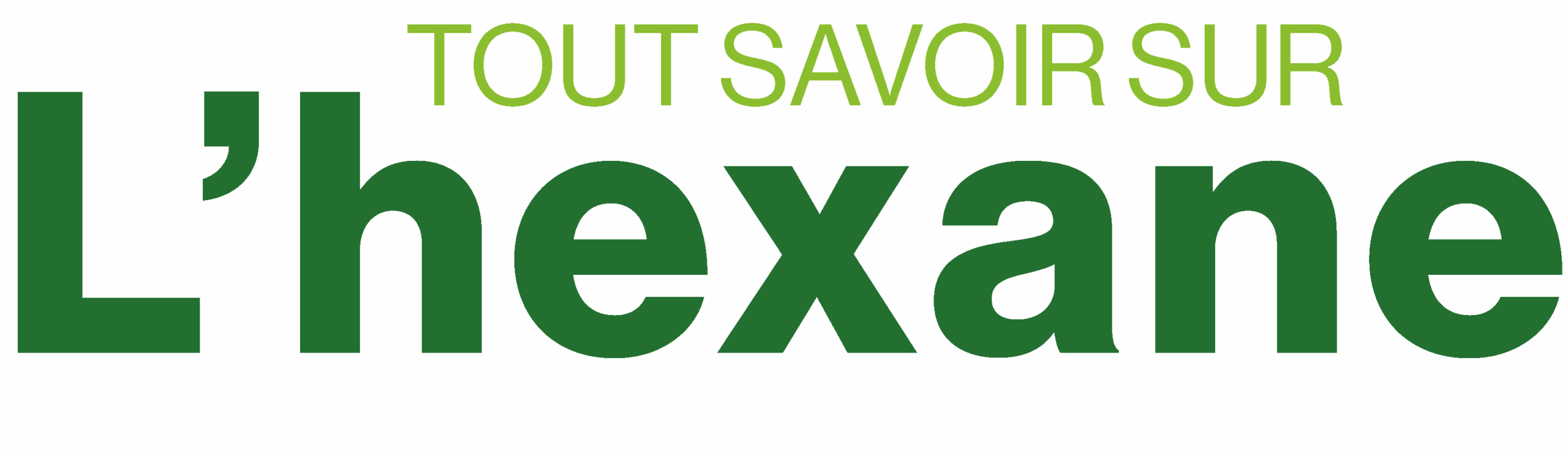
L’hexane dans l’alimentation : pour un débat rigoureux et transparent
7 affirmations fréquentes passées au crible de la science
Depuis plusieurs mois, l’hexane fait l’objet d’un traitement médiatique susceptible de créer des inquiétudes infondées chez les consommateurs. Parce que la confiance du public est essentielle et que la santé des consommateurs constitue une priorité absolue pour notre secteur, la Fédération Nationale des Corps Gras (FNCG) souhaite rappeler un certain nombre d’informations factuelles indispensables à la bonne compréhension de ce sujet.
L’hexane est un auxiliaire technologique utilisé depuis des décennies dans de nombreux secteurs alimentaires, notamment pour l’extraction des huiles végétales, des arômes, du chocolat ou de certains additifs. Il ne s’agit ni d’un ingrédient ni d’un additif : par définition, un auxiliaire technologique n’a aucun rôle dans le produit fini et n’y subsiste qu’à l’état de traces infinitésimales. Ce statut, qui découle du règlement (CE) n°178/2002, repose sur une exigence : ces traces doivent être inférieures à des seuils réglementaires stricts, fixés pour garantir la sécurité des consommateurs.
Aucune alerte sanitaire
Le cadre en vigueur est parfaitement clair. Au niveau européen, la directive 2009/32/CE fixe une limite maximale de résidus (LMR) d’hexane de 1 mg/kg dans les huiles alimentaires. Cette limite a été rappelée à plusieurs reprises par les autorités sanitaires comme protectrice de la santé publique. Elle est strictement respectée par les industriels français, dont les analyses montrent des niveaux résiduels généralement dix à vingt fois inférieurs à cette valeur réglementaire. Comme l’ont indiqué l’EFSA et la Commission européenne à l’hiver 2024-2025, il n’existe aujourd’hui aucune alerte sanitaire liée à la consommation d’huiles ou de produits alimentaires contenant des traces d’hexane conformes à la réglementation.
Malgré cela, l’hexane est très souvent présenté dans le débat public comme un solvant « controversé » présentant un risque sanitaire avéré pour la population. Ce constat ne repose sur aucune base scientifique solide : il s’appuie sur des analyses issues d’un laboratoire non accrédité, dont la fiabilité n’est pas documentée et dont les méthodes ne sont pas rendues publiques à ce jour. Comme nous l’avons déjà indiqué[1], un biais de mesure lié à l’utilisation d’hexane dans certaines méthodes d’analyse des matières grasses peut conduire à des « faux positifs ». La transparence sur les protocoles utilisés est donc indispensable pour garantir des résultats reproductibles et exploitables scientifiquement.
Un cadre réglementaire exigeant
Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler le rôle central des autorités sanitaires européennes. L’EFSA a engagé une réévaluation de l’hexane, conformément aux procédures régulières qui s’appliquent à de nombreux auxiliaires technologiques. Les industriels ont répondu de manière complète et transparente à l’appel à données lancé dans ce cadre, et l’évaluation inclura également une analyse des méthodes de mesure disponibles. Il s’agit d’un processus normal, prévu par la réglementation, qui ne préjuge en rien des conclusions futures, et dans lequel la profession réitère sa pleine confiance.
Il est regrettable que cette réévaluation soit présentée, dans certains discours, comme la preuve d’une défaillance des normes en vigueur ou d’un risque déjà avéré. De tels raccourcis alimentent la défiance, fragilisent le rôle des agences sanitaires et contribuent à installer l’idée fausse selon laquelle l’industrie agroalimentaire chercherait à contourner les règles ou à négocier avec la santé publique. La confusion entre « danger » et « risque », comme l’analogie répétée entre les traces résiduelles potentiellement présentes dans les aliments et les expositions professionnelles à des vapeurs d’hexane n’aide ni les consommateurs (elle les trompe) ni la qualité du débat scientifique.
Certaines affirmations relayées publiquement reposent en outre sur des contresens. Présenter le tourteau comme un simple résidu « contaminé » occulte sa nature de coproduit essentiel de la filière, riche en protéines et indispensable à la souveraineté alimentaire française. Grâce aux productions oléagineuses nationales, la France a porté son autonomie en protéines végétales à près de 55 %, contre environ 30 % en moyenne dans les autres États membres de l’Union européenne. Dégrader l’image de cette filière ne conduirait qu’à renforcer la dépendance aux importations.
Enfin, plusieurs prises de position publiques laissent entendre que les limites réglementaires actuelles seraient obsolètes ou insuffisantes. Au contraire, la Commission européenne elle-même a indiqué, après le premier rapport technique de l’EFSA de septembre 2024, qu’aucune modification des LMR n’était justifiée à ce stade. La réévaluation en cours vise précisément à actualiser la littérature scientifique et non à répondre à une quelconque alerte sanitaire.
Des démarches de progrès constantes
La FNCG réaffirme donc que la sécurité des consommateurs est le fondement des métiers qu’elle représente. La profession continue à améliorer ses pratiques, à réduire les résidus lorsque cela est techniquement possible, et à contribuer de manière transparente à tous les travaux scientifiques engagés par les autorités. Mais elle souligne aussi les limites inhérentes au traitement médiatique d’un sujet éminemment technique. La couverture actuelle en est une illustration : en dépit des données disponibles, l’hexane y est souvent présenté comme un « scandale d’Etat ». Une telle affirmation, dépourvue d’assise factuelle, contribue à installer un climat de suspicion préjudiciable à la compréhension des enjeux alimentaires et à la confiance du public. Pire encore, elle nourrit l’idée infondée, et l’accusation grave, d’une collusion entre pouvoirs publics et acteurs industriels, laissant croire que des considérations économiques primeraient sur la protection de la santé des consommateurs.
Dans un moment où les attentes sociétales sont fortes, il est essentiel de maintenir un débat public serein, rigoureux et fondé sur les faits. La FNCG appelle l’ensemble des acteurs – institutions, scientifiques, ONG, médias, industriels – à participer à cette exigence, dans l’intérêt de la santé publique, de la souveraineté alimentaire et de la qualité de l’information donnée aux consommateurs.
7 affirmations fréquentes passées au crible des faits
| Erreurs | Faits vérifiés |
| L’industrie cacherait l’utilisation de l’hexane. | L’utilisation de l’hexane est publique, ancienne et rigoureusement encadrée par la directive européenne 2009/32/CE et par un arrêté français. |
| L’hexane serait un solvant controversé, potentiellement dangereux même à faibles doses. | Les résidus dans les aliments sont infinitésimaux et largement en dessous de la LMR (Limites Maximale de résidu) de 1 mg/kg, elle-même fixée avec une marge de sécurité d’un facteur 20 par rapport au seuil d’effet toxicologique (NOAEL). |
| L’EFSA aurait reconnu un risque sous-estimé pour les consommateurs, notamment les enfants. | L’EFSA a volontairement surestimé l’exposition (scénario “pire des cas”). Elle précise que l’exposition réelle est très inférieure grâce aux pratiques industrielles. Aucune alerte sanitaire n’a été signalée. |
| Les analyses montrant des résidus proviendraient de laboratoires fiables. | Les enquêtes citées proviennent d’un laboratoire non accrédité, aux méthodes non publiées et non reproductibles. Les laboratoires accrédités n’obtiennent pas ces résultats. |
| Le tourteau serait un résidu contaminé. | Le tourteau est un coproduit essentiel, riche en protéines, indispensable à l’alimentation animale et à la souveraineté protéique française. |
| La réglementation actuelle serait obsolète et insuffisante pour protéger le public. | La Commission européenne a confirmé en janvier 2025 qu’aucune modification de la LMR n’est justifiée. Les normes actuelles assurent un niveau de sécurité élevé. |
| L’hexane perdu dans les produits et l’atmosphère représenterait une part importante du procédé. | 99,93% de l’hexane est recyclé dans le procédé industriel. Les pertes sont donc extrêmement faibles (environ 0,07 %). |
[1] INFORMATION PRESSE FNCG – 22 SEPTEMBRE 2025




1 réflexion sur « HEXANE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18 NOVEMBRE 2025 »
Les commentaires sont fermés.