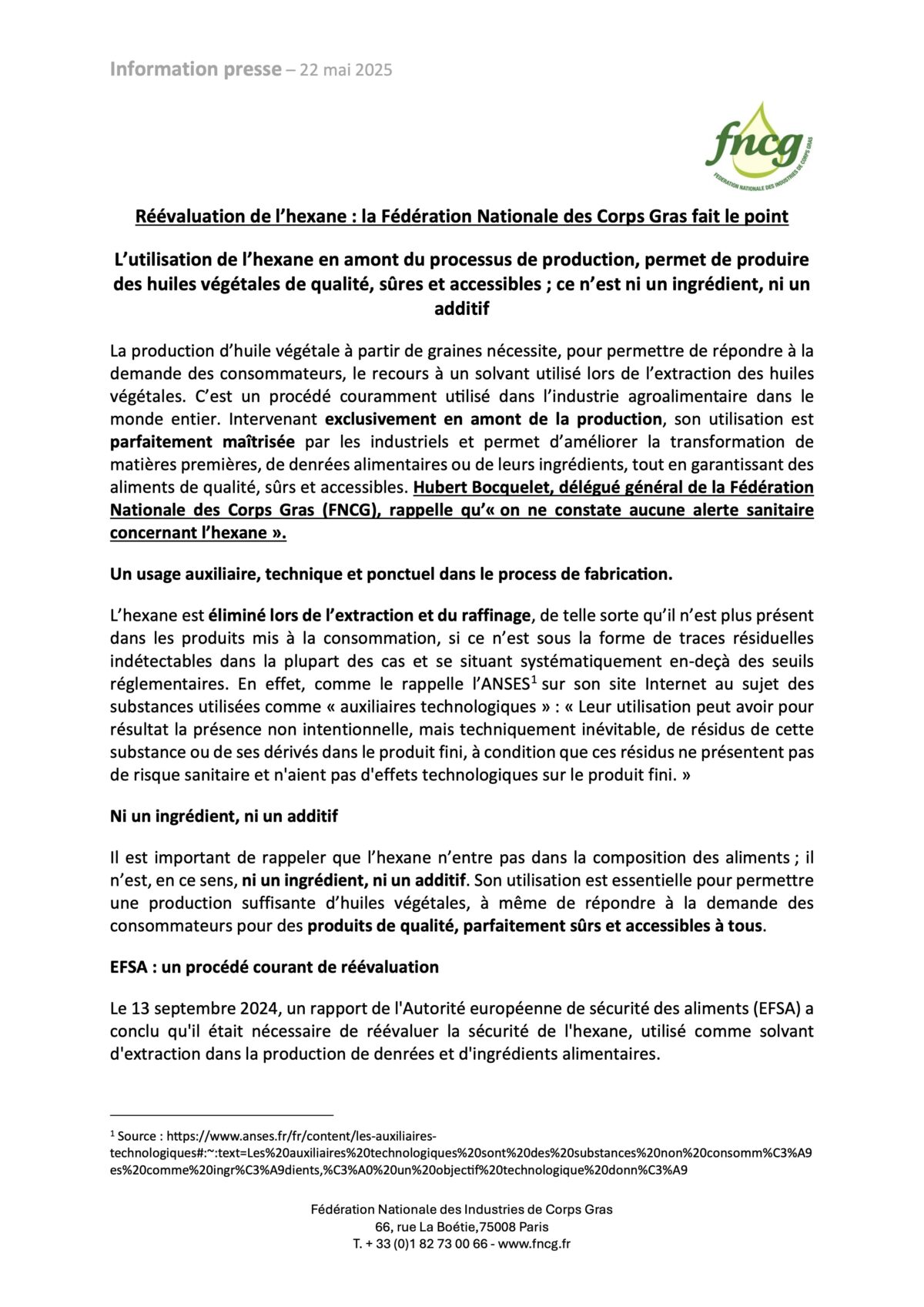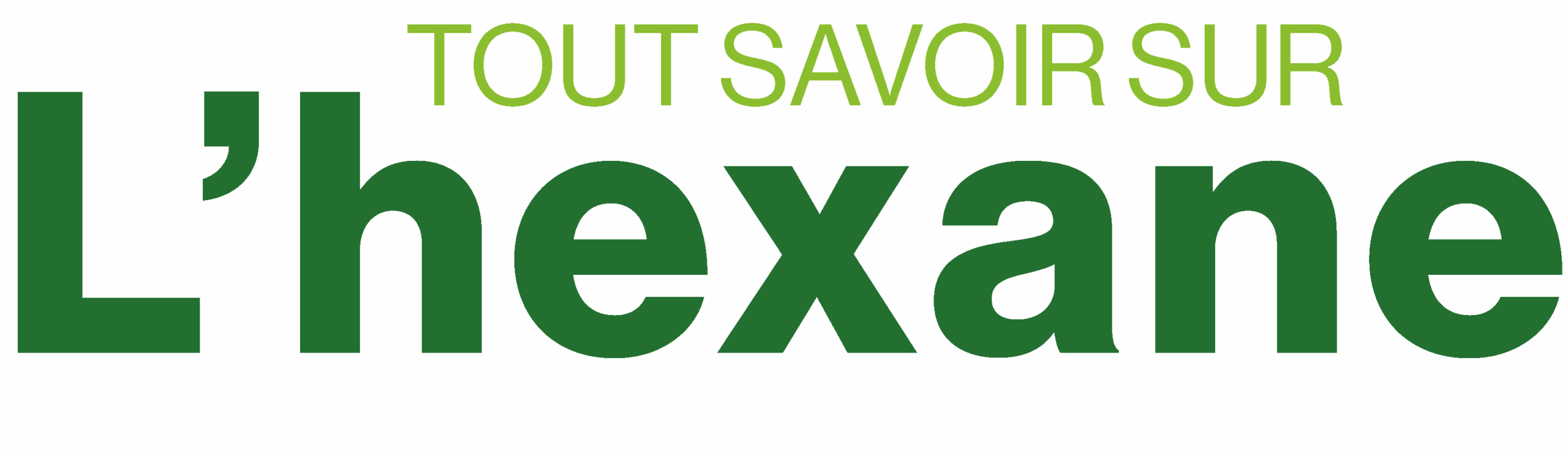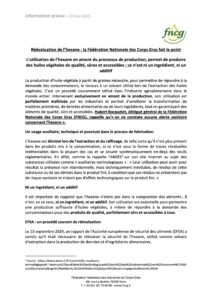Les huiles végétales issues des graines (colza, lin, soja, noix, etc.) :
des alliées nutritionnelles de notre alimentation
La Fédération Nationale des Industries des Corps Gras (FNCG) souhaite rappeler l’effet santé de certains nutriments des huiles de graines ; les données scientifiques récentes mettent en évidence que les huiles végétales participent à la régulation de l’inflammation et, plus largement, qu’elles contribuent au maintien d’une bonne santé métabolique. Les matières grasses n’ont pas toutes les mêmes effets sur l’organisme : il est important de rappeler qu’une alimentation variée en huiles végétales, issues des graines oléagineuses comme le colza, la noix ou le lin, est recommandée.
- Rappel des effets santé des nutriments des huiles végétales reconnus par les autorités
Il est important de rappeler que les huiles végétales contiennent des nutriments, tels que les oméga 3 (acide alpha linolénique ALA) et les oméga 6 (aide linoléique AL), qui contribuent à certains effets sur la santé reconnus1 par les autorités européennes.
En effet, les oméga 3 (ALA) et les oméga 6 (AL) contribuent au maintien d’une cholestérolémie normale pour une consommation de 2g/jour d’O3 (ALA) et de 10g/jour d’O6 (AL). De manière plus générale, il convient de rappeler que le remplacement des graisses saturés par des graisses insaturés (dont font partie notamment les oméga 3 ALA et oméga 6 AL) dans le régime alimentaire contribue au maintien d’une cholestérolémie normale.
Il est également reconnu que les oméga 3 (ALA) et les oméga 6 (AL) sont nécessaires à la croissance et à un développement normaux des enfants pour une consommation de 2g/jour d’O3 (ALA) et 10g/jour d’O6 (AL).
- Des vertus confortées par les recommandations officielles françaises
Les travaux de l’ANSES et les recommandations du Programme National Nutrition Santé (Manger Bouger) sont également clairs : limiter les acides gras saturés, principalement issus des graisses animales, favoriser les acides gras insaturés, en particulier les oméga-3 d’origine végétale, et diversifier les sources lipidiques, en privilégiant les huiles de colza, de noix et d’olive. Ces recommandations sont issues d’une synthèse approfondie des connaissances nutritionnelles. Elles rappellent qu’en France, la population consomme trop de graisses saturées et pas assez d’acides gras polyinsaturés, pourtant essentiels à la santé.
« De nouvelles études scientifiques démontrant que les huiles végétales contribueraient à la régulation de l’inflammation
Alimentation et inflammation entretiennent des relations étroites. L’inflammation est un processus physiologique essentiel : elle protège l’organisme et favorise la réparation des tissus. Mais lorsqu’elle persiste, elle devient le facteur commun de nombreuses maladies chroniques. Les travaux2 du Pr. Jean-Michel Lecerf (Institut Pasteur de Lille) soulignent que cette « inflammation de bas grade » est modulée par l’alimentation : une diète riche en produits végétaux, en fibres, en prébiotiques, en polyphénols, ainsi qu’en acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6) serait anti-inflammatoire.
En plus de leur rôle métabolique, les huiles végétales s’intègrent dans une alimentation, plus largement, favorable à la santé : une alimentation riche en produits végétaux, en fibres et en composés antioxydants. Ce modèle alimentaire se rapproche fortement du régime méditerranéen, dont les bénéfices santé sont largement démontrés, et est soutenu par les travaux de l’Institut Pasteur de Lille et de l’INRAE.
« Les huiles végétales contribuent, au vu de ces dernières données, à prévenir les inflammations chroniques à l’origine de nombreuses pathologies comme le diabète l’obésité et l’athérosclérose lorsqu’elles sont consommées dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée », rappelle Hubert BOCQUELET, délégué général de la Fédération Nationale des Corps Gras (FNCG).
- L’importance du juste équilibre entre oméga-3 et oméga-6
Ces publications3 désignent les acides gras polyinsaturés — oméga-3 et oméga-6 — comme des composantes essentielles de notre équilibre inflammatoire. Les oméga-3, présents dans les huiles de colza, de lin, de soja ou dans les noix, mais aussi dans les poissons gras (saumon, maquereau, sardine, hareng, anchois), jouent un rôle clé dans la résolution de l’inflammation. Ils participent à la synthèse de molécules récemment identifiées — les résolvines et protectines —, qui régulent activement la durée et l’intensité de la réaction inflammatoire, évitant ainsi la destruction tissulaire. Les oméga-6, présents dans certaines huiles végétales, la viande et les œufs, contribueraient également au bon fonctionnement du système immunitaire et à la coagulation sanguine. Cependant, consommés en excès, ils peuvent favoriser une inflammation chronique en rompant l’équilibre avec les oméga-3.
Aujourd’hui, dans les régimes occidentaux, ce ratio oméga-6/oméga-3 est fortement déséquilibré en faveur des oméga-6. Les études internationales, notamment celles de Simopoulos (2019) et de Djuricic & Calder (2021), rappellent la nécessité de rééquilibrer ces apports pour soutenir la santé métabolique et cardiovasculaire.
Ainsi, les huiles végétales issues des graines (colza, lin, soja, noix, etc.) sont recommandées pour contribuer à l’équilibre nutritionnel et jouent un rôle actif, au vu des récentes données scientifiques, dans la prévention des déséquilibres inflammatoires. Plutôt que d’opposer les matières grasses entre elles, il convient de reconnaître la complémentarité des acides gras et de promouvoir un usage équilibré et raisonné des huiles végétales, au cœur d’une alimentation variée et durable.
- voir Règlement (CE) n°1924/2006 et Registre européen des allégations ↩︎
- Pratiques en nutrition n° 77 / janvier-mars 2024 / Jean-Michel LECERF Chef du service Nutrition et activité physique Institut Pasteur de Lille,
Dossier l’inflammation métabolique /
Qu’est-ce qu’une alimentation inflammatoire ? ↩︎ - https://doi.org/10.1051/ocl/2019046
Acides gras oméga-6 et oméga-3 : endocannabinoïdes et obésité / Artemis P. Simopoulos / The Center for Genetics, Nutrition and Health, 4330 Klingle Street NW, 20016 Washington DC, United States / oct 2019 ↩︎
À propos de la FNCG
La Fédération des Industries des Corps Gras rassemble les différentes activités industrielles du secteur de la production et transformation de matières grasses végétales : familles professionnelles des huileries et margarineries et des bougies. La FNCG fournit à ses adhérents les informations en matière sociale, économique, technique, environnementale et juridique intéressant leur activité. Nos Professions relèvent de façon générale de l’ensemble des secteurs utilisateurs de corps gras : alimentaire, alimentation animale, autres usages techniques (chimie, cosmétique, peinture, vernis).